Jeudi 30 avril
Ma grand-mère maternelle était née un 30 avril. Elle aurait eu 115 ans aujourd’hui. Je n’ai plus de grands-parents depuis 2001. Mais en 2013, je suis moi-même devenue grand-mère pour la première fois. Hier soir, un échange de textos avec ma fille m’a fait « grimper dans les tours ». Elle m’avouait que son frère et sa belle-sœur étaient passés à son domicile pour lui annoncer leur prochain mariage. Elle reconnaissait qu’ils avaient transgressé les règles du confinement, mais ajoutait qu’à leur décharge, ils n’étaient pas sujets à risque.
Alors quoi ? Parce que je souffre de problèmes cardiaques depuis cinq ans, et qu’on vient de me découvrir une nouvelle anomalie, la levée du confinement serait une faute ? Le jeune couple aurait des circonstances atténuantes pour sa transgression et moi des circonstances aggravantes pour le respect de la date du 11 mai ? À défaut d’une faute légale, je serais coupable d’une faute morale en allant prendre mes petits-enfants dans mes bras. La double peine…
Quelques heures plus tard, mon fils en avait remis une couche : comme j’avais vu aux informations que nous pouvions aller visiter un proche blessé, je lui avais demandé s’il pourrait m’envoyer un certificat médical attestant qu’il s’était cassé le pied, mais il m’avait rappelé qu’il vivait en couple et qu’avec mes problèmes, je devrais patienter. Au nom de mon soi-disant intérêt, on m’empêchait donc de reprendre le cours de ma vie. Ma vie. Quel est le sens d’une vie sinon les liens ? Liens familiaux, liens amicaux, liens professionnels, liens sociaux. Heureusement que mes clients ignorent tout de mon état de santé et quand bien même le connaitraient-ils, ils ne s’autoriseraient pas à me protéger malgré moi…
La colère et la tristesse ne sont pas retombées ce matin, mais j’essaye de les contenir en attaquant le travail avec courage. J’écoute pour commencer les deux dernières lettres audios de Myriam. Très décousues. Très maussades. Pires que maussades : angoissantes. Je ne suis pas bien sure de tout saisir. Ou d’être capable de tout m’approprier. Comprendre, c’est littéralement prendre avec soi. Et certains mots m’échappent, glissent d’abord sur le bloc-notes, dérapent ensuite sur le clavier.
Je suis biographe depuis quelques mois, mais j’ai recueilli de nombreux récits de vie pour mes recherches depuis de très nombreuses années. Et je constate en toute sincérité que, malgré toute la rigueur du monde, je ne peux véritablement écrire que ce en quoi je crois un tant soit peu. Même si je dois m’effacer derrière la vie de l’autre, je l’incarne. Comme un comédien. L’auteur passe en moi comme le personnage passe en l’acteur. Nous ne sommes pas que la main qui écrit sous la dictée ou la voix qui répète les mots. Nous interprétons. Au sens noble du terme.
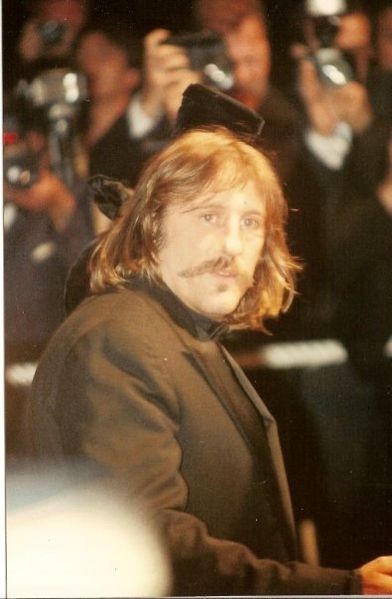
Alors je « travaille » le mémo vocal de Myriam (c’est ainsi qu’elle appelle ses lettres enregistrées) comme, je suppose, le metteur en scène fait travailler à ses acteurs un texte de Molière ou de Rostand. Ne pas trahir, mais traduire. Rendre acceptable pour d’autres ce qui, sans notre intervention, n’aurait pas été acceptable pour nous. Traduire, c’est transmettre. Donc je réduis ou je développe, c’est selon. J’atténue ou j’accentue. J’implicite ou j’explicite. J’enrobe ou je dérobe. Je place ou je déplace. Mais bien entendu, toujours je soumets.
Je cours ensuite vers le récit d’une des six femmes avec lesquelles je prépare l’ouvrage collectif sur la souffrance au travail. Une de mes « potes dépressives ». Cette fois, c’est Aude. Récit ciselé. Je ne l’ai pas fait exprès, mais elle est couturière ! Et elle devra en faire des découpes et des ourlets dans son beau texte, car, même après lui avoir proposé d’ôter de nombreux passages, il fait encore le double du mien, qui se situe dans la moyenne ! Elle en convient, s’y attendait, a voulu me montrer qu’elle était près du but.
Je recevrai dans la journée un courriel des deux assistantes sociales de la CARSAT à l’origine du groupe d’échanges qui nous a fait toutes nous rencontrer, et je pourrai le leur annoncer avec fierté : j’ai déjà réuni six récits sur les sept que notre livre comptera. Pour leur part, elles ont commencé à rédiger l’avant-propos. Mais nous devions nous réunir avec elles le 29 mai et elles se demandent s’il n’est pas plus prudent d’annuler cette séquence. Ou de la réaliser en visio. Une fois de plus, la précaution…
En fin d’après-midi, après quelques courses, nous recevons, Stéphane et moi, un constructeur pour nos futurs travaux. Nous avons besoin d’un autre avis. D’un deuxième devis. Et nous avons bien fait, car celui-ci nous suggère un autre matériau, un autre équipement. Pendant ce temps, ma fille et mon gendre cherchent à nous joindre, mais nous ne répondons pas à leurs appels. Ma fille s’inquiète. Et puis, je ne l’ai pas contactée depuis ma colère de la veille. Elle sait que j’ai été froissée. Elle est rassurée quand je décroche alors même que notre visiteur vient à peine de passer la porte. Ça tombe bien, son conjoint a simulé notre projet en 3D à partir d’un logiciel gratuit très performant. Je peux lui dire de vive voix comment ce nouveau rendez-vous vient l’infléchir, le modifier.
Mon gendre en profite pour me parler du récit que j’ai formulé à partir de l’interview qu’il a accepté de m’accorder pour « Dire le travail au temps du confinement ». L’écrit est très fidèle, mais il s’est laissé un peu aller. S’est rendu compte que son employeur pouvait le reconnaitre. Je dois enlever les éléments personnels qui permettraient à coup sûr de l’identifier. Il rit au bout du fil, trouve que ma plume est « engagée ».
L’interprétation. L’incarnation. La traduction.
Corinne Le Bars, écrivain public et biographe

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.