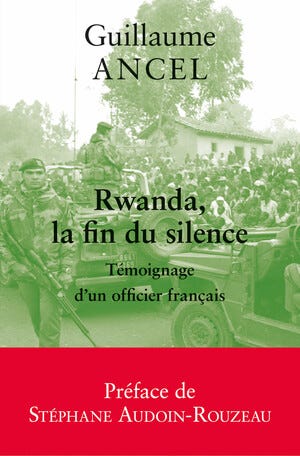À propos de Rwanda, la fin du silence –Témoignage d’un officier français (Guillaume Ancel, Les Belles Lettres, 2018). Préface de Stéphane Audoin-Rouzeau.
Ce livre, paraissant dans une collection intitulée « Mémoires de guerre » est-il un récit de travail ?
Un récit, indéniablement : le narrateur relate jour après jour sa mission dans le cadre de l’opération Turquoise au Rwanda à l’été 1994. Sa convocation, en tant que spécialiste du guidage depuis le sol des bombardements aériens, pour rejoindre une unité de la Légion étrangère envoyée dans ce pays ravagé par ce qu’on désigne alors comme « une guerre civile » ; la non moins soudaine réorientation de sa mission, alors que les avions qu’il devait guider pour bombarder des positions du Front patriotique rwandais sont brusquement renvoyés à leur base sur ordre de l’Élysée, Turquoise devenant une opération d’abord « humanitaire » ; et donc la réaffectation du capitaine à des missions de sauvetage de civils tutsis encore pourchassés par les milices du régime génocidaire, tâche qui l’occupera, dans des conditions très éprouvantes, jusqu’à son rapatriement fin juillet 1994 ; sa confrontation aux rescapés des massacres, aux proches des disparus recherchant désespérément des nouvelles, mais aussi aux responsables cyniques, voire aux massacreurs qui se fondent dans le décor, le vent ayant tourné. C’est bien le récit de la confrontation à un évènement hors norme : un génocide. Et c’est encore sur le mode narratif que l’auteur termine son livre en évoquant son cheminement les années suivantes, quand il veut comprendre ce qu’il a vu dans ces jours traumatisants : comment interpréter en particulier le jeu politique complexe de l’État français, tout ce que le récent rapport Duclert a décidé de ne pas qualifier de « complicité » ?
Un travail ? L’expression peut sembler curieuse, en tout cas à mes oreilles, pour une mission militaire. Mais une activité, indéniablement, avec ses prescriptions, fort nombreuses dans ce milieu professionnel ; mais aussi ses renormalisations, parce qu’il y a des ordres inapplicables, ou à moitié, ou seulement en trichant plus ou moins ; ses problèmes d’ordre technique, d’organisation du travail, de négociations pour obtenir les moyens de faire ce qui est demandé ; ses dilemmes, comme dans cette scène sidérante où des officiers doivent discuter d’une proposition d’un adjudant-chef de « pousser un peu » un interrogatoire pour obtenir des renseignements d’un prisonnier (finalement non, il apparait qu’il ne vaut mieux pas) ; ses reconnaissances incertaines, le sens du travail bien fait n’étant pas nécessairement partagé, et les controverses sur les conceptions différentes que les uns et les autres peuvent en avoir n’étant guère encouragées. Le capitaine, devenu tout de même lieutenant-colonel, finira par démissionner. Il raconte à la fin du livre à quel point son souci du témoignage et ses questions sur le rôle de l’État français dans le génocide des Tutsis lui vaut des inimitiés dans le milieu.
C’est donc bien le récit de l’engagement de professionnels dans leur activité. Il est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit là d’abord de sauver des vies et non pas d’en supprimer (même si, autre dilemme s’il en est, le capitaine se retrouve en supprimer pour en sauver).
C’est une parole forte, qui vaut une enquête journalistique ou une étude savante, ou du moins les complète. Elle est ancrée dans la réalité, et fait exploser, si on peut dire, les mensonges que continuent à proférer sans vergogne les chefs d’état-major. C’est le bon niveau pour discuter des questions de responsabilités ou de complicités : que faire quand, officier subalterne, on se rend compte qu’un convoi d’armes qu’on est censé contrôler est destiné aux milices génocidaires en train de se reconstituer parmi les camps de réfugiés, qu’on n’a pas forcément les forces disponibles pour s’y opposer, qu’on constate que la hiérarchie laisse faire, pour d’obscures raisons ? Ce ne sont pas alors des problèmes moraux abstraits, ou des débats historico-juridiques parisiens, mais des questions de travail.
En parler est salutaire d’abord pour le professionnel, qui raconte son retour difficile à la normalité de la vie sociale dans la France estivale qui vaque à ses occupations, guère troublée par un génocide « pas trop important ». Il a fait quelque chose de ci qu’il a vécu en en parlant, dans son entourage, en s’obstinant à en parler, malgré les réticences et même la franche hostilité, jusqu’à ce livre.
Salutaire ensuite à titre politique. Ce récit permet de montrer tout ce que la société gagnerait à ce que ceux qui savent, de par leur travail, parlent publiquement de ce qu’ils font ou ont fait. Si les militaires, officiers ou simples soldats, si toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les bureaux de l’Élysée, du Quai d’Orsay, des états-majors, pouvaient, décidaient de s’exprimer librement, si l’on considérait comme légitime et même impérieux qu’ils puissent raconter leur travail, on n’en serait pas réduit à attendre des décisions politiques pour l’ouverture des archives. On peut même penser, c’est mon cas, qu’on pourrait éviter de funestes décisions, dénoncer immédiatement de sinistres complicités, parvenir enfin à ce que « plus jamais ça ».
Patrice Bride