Ce texte est issue d’une intervention de Patrice Bride à un colloque organisé en mars 2018 par la Mission ouvrière. Il présente la démarche de la coopérative : le travail qu’il s’agit de dire, la méthode choisie pour l’entendre et le mettre en textes, ce que nous en entendons au travers de nos récits, et enfin nos motivations à le faire dire.
Notre coopérative Dire Le Travail a pour objet de mettre le travail en mots, en discussion, en textes. Mais quel est ce travail que nous prétendons dire ? Le terme doit être explicité : il est polysémique, et chargé de représentations et de valeurs. Il est connoté parfois très positivement, dans le registre de la passion ou de la création, parfois très négativement, du côté de la souffrance ou de l’aliénation.
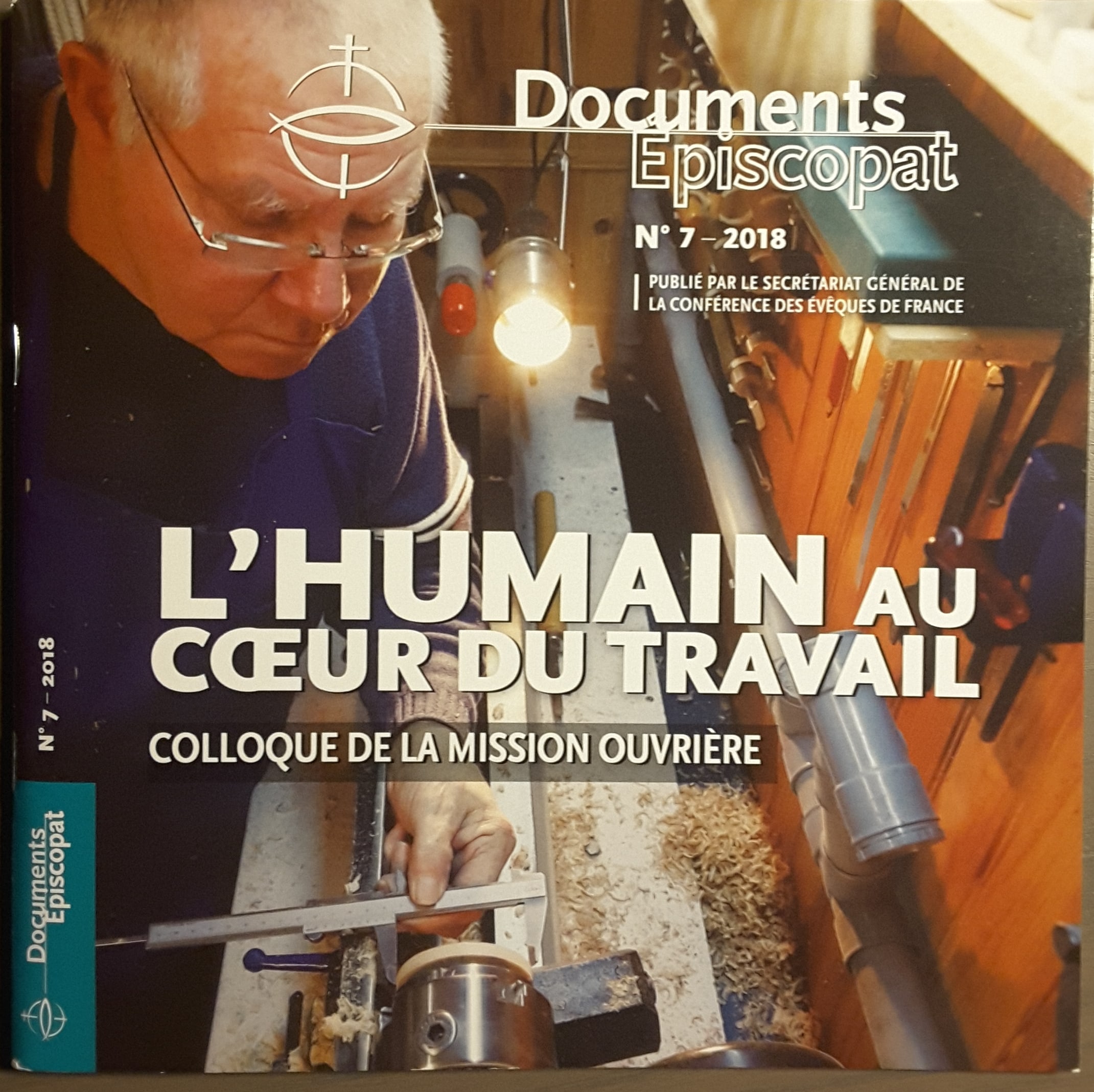
Quel est ce travail que nous prétendons dire ?
Soulignons d’abord notre souci de distinguer le travail de l’emploi. Un emploi désigne une occupation bornée dans le temps : on embauche à 8 h le matin, on quitte son poste à 17 h le soir, et le reste du temps est autre chose : des loisirs, du repos, de la vie privée, de la vie sociale. On recherche un emploi à l’issue de la scolarité, après l’insouciance de l’enfance, jusqu’à l’âge fatidique de la retraite, pour profiter enfin d’une vie sereine et paisible. L’emploi désigne une activité rémunérée, contractualisée. Le travail qu’il s’agit de « dire » pour nous est à entendre dans un sens beaucoup plus large : ce que l’on « fait dans la vie », pour reprendre le titre de notre livre. C’est le travail qui occupe l’esprit parfois dès le réveil, et encore souvent bien après être rentré chez soi. C’est le travail dont on rêve dès l’enfance, ou encore le travail auquel on peut enfin se consacrer pendant sa retraite, quitte à ce qu’il soit bénévole. C’est le travail au sens de tout ce que l’on fait, bien au-delà de ce qu’on est censé faire à son poste, de ce qui est prévu dans le contrat avec l’employeur.
Dans une expression ordinaire, on dit parfois que l’on travaille « pour gagner sa vie ». Certes, au sens prosaïque : pour obtenir un revenu, alimenter son compte en banque. Mais on dit aussi : « ne pas perdre sa vie à la gagner ». Il y a bien autre chose à gagner et à perdre au travail qu’un revenu. Le travail peut rendre la vie plus riche. Il peut même donner un sens à son existence, parce que l’on est fier de ce que l’on fait, parce que l’on se rend utile à d’autres. C’est, dans une première entrée, ce travail que nous ambitionnons de faire dire à nos interlocuteurs.
Et ce n’est pas une lubie : les personnes que nous rencontrons ont beaucoup de choses à nous dire dans ce registre. Elles acceptent avec bonne volonté, parfois même soulagement, d’évoquer ce qui les porte dans le travail : un engagement personnel, une recherche d’accomplissement au travers d’une activité, l’envie et le besoin d’être utile aux autres. Ainsi, j’ai rencontré pour un entretien deux conducteurs de TGV. Tous les deux font le même métier, ont à peu près la même expérience de la conduite, et sont même fonctionnellement interchangeables : si l’un est empêché de prendre son poste, il faut que l’autre puisse le remplacer au pied levé, d’une façon transparente pour leurs collègues comme pour les passagers. Je prenais donc le risque qu’ils me racontent la même histoire. Mais ce sont bien deux personnes différentes que j’ai interviewées, qui ont certes les mêmes tâches à effectuer, mais qui en fait ne font pas la même chose « dans leur vie ». Ces deux conducteurs n’ont pas les mêmes préoccupations, les mêmes priorités, les mêmes satisfactions à leur travail. Il ne s’agit bien sûr pas de les opposer ou de donner raison à l’un ou à l’autre, mais de prendre la mesure de la diversité des rapports singuliers que chacun entretient avec le travail.
Il y a donc bien de quoi constituer des récits. Mais si nous nous intéressons tant au travail, ce n’est pas seulement pour saisir dans nos textes ces engagements subjectifs. On travaille pour soi, sur soi, mais on travaille aussi pour les autres, avec les autres. Le travail est aussi une activité sociale. Un travail inutile est insupportable : ainsi d’un vigile de nuit dans un immeuble de bureaux sous alarme, qui sait qu’il n’est là que parce que sa présence est requise par le contrat d’assurance. Il n’avait rien à faire, et il n’en pouvait plus de ne rien faire. Si travailler donne une existence sociale, c’est par la contribution que l’on apporte à une œuvre commune, au fonctionnement du monde. C’est bien pour cela que nos récits peuvent toucher le lecteur : ce sont des rencontres, avec des personnes que l’on côtoie dans la société, mais aussi des personnes qui agissent sur nous parce qu’elles conduisent les trains, parce qu’elles nous protègent, nous soignent, nous alimentent, nous cultivent.
Comment nous y prenons-nous pour faire dire ce travail ?
Le projet initial de la coopérative était d’ouvrir un espace d’expression, mais plutôt dans l’idée de laisser la plume aux travailleurs. Nous avions la conviction, généreuse, mais peut-être un peu naïve, que, dans notre société fortement scolarisée, l’immense majorité des travailleurs maitrisent suffisamment l’écrit pour être en mesure de dire leur travail, pourvu qu’on le leur propose, pourvu qu’on les accompagne dans la démarche. Pas si simple… Un entretien préalable, pour être dégagé de la charge du passage à l’écrit, a montré tout son intérêt : en évoquant d’abord ce qu’il y a à dire, pour réfléchir ensuite à la meilleure manière de le mettre par écrit. Et puis, chemin faisant, nouvelle découverte : un entretien sur le travail ne consiste pas à communiquer à son interlocuteur quelque chose qui serait déjà présent à l’esprit, dont il y aurait juste à rendre compte en le mettant en mots. L’entretien est une interaction entre celui qui s’exprime et celui qui l’amène à s’exprimer, orientée vers un projet commun, en l’occurrence préparer une publication. Une belle analogie : conduire un entretien, puis le mettre en récit, c’est comme prendre une photographie. La personne photographiée accepte de se montrer, choisit ce qu’elle veut montrer d’elle, quitte à découvrir que ce qu’elle montre n’est pas ce qu’elle croyait. Le photographe ne se contente pas de capter un morceau de réel, parce qu’il a son regard, ses choix esthétiques. Il met de lui dans la photographie autant que son sujet. Deux photographes ne feront pas le même portrait d’une personne. Au final, c’est bien sûr la personne photographiée qui a droit de regard sur la publication de l’image ; mais il a fallu le travail du photographe pour que le portrait attire l’attention du spectateur, l’interpelle, lui parle. De la même manière, deux collecteurs de notre coopérative ne conduiront pas le même entretien, ne produiront pas le même récit. Dans notre méthodologie, c’est bien sûr celui qui a raconté son travail qui a le dernier mot sur le texte. Mais le travail du rédacteur est indispensable pour mettre en valeur ce qu’il a fait dire de l’activité de son interlocuteur, le porter aux lecteurs qui en sont les destinataires.
Que nous disent nos interlocuteurs ?
Trois idées fortes ressortent de ces récits.
Tout d’abord le constat qu’aucun travailleur ne peut se contenter de faire ce qu’on attend de lui. Chacun déborde nécessairement le cadre prescrit par son poste, parce qu’il y a toujours de l’inattendu dans l’activité, parce qu’on ne peut jamais réduire l’action sur la réalité à des procédures à appliquer. Ainsi ce dermatologue dont le métier est à priori bien circonscrit : ses patients attendent de lui qu’il soigne leurs problèmes de peau. Mais lui nous a dit mesurer très bien que les symptômes qu’on lui décrit, qu’il observe, signalent des troubles internes complexes et délicats, que ne suffira pas à traiter la pommade. Mais il nous a dit aussi ne pas être psychologue, ni assistant social, n’avoir ni les compétences ni les ressources pour intervenir sur les causes du malaise qui se manifeste par un herpès, un eczéma ou un psoriasis. Il doit se contenter de faire ce qu’il sait faire, délivrer l’ordonnance attendue. Mais il sait aussi que pour bien faire son travail, il doit, devrait en faire un peu plus. Ça l’embarrasse, et c’est cet embarras-là qui constitue le défi de chaque rendez-vous, qui l’occupe, et dont il nous fait part fortement dans son récit.
Autre exemple : un jeune brancardier en hôpital, chargé de transporter les personnes de leur chambre vers le bloc opératoire, et retour. Mes premières questions étaient techniques : comment fait-on pour déplacer délicatement une personne du lit sur le brancard, opération indispensable, mais risquée ? Comment fait-on pour manipuler les personnes sans aggraver leur état ? Mais ces aspects du métier ne l’intéressaient pas beaucoup, parce qu’il les maitrisait, parce qu’il effectuait les bons gestes sans avoir besoin d’y réfléchir. Ce qu’il avait envie de me raconter lui appartenait en propre. Il s’était fixé un défi personnel à chaque nouveau malade : faire en sorte que celui qu’il prend en charge dans un certain état de crispation, inquiet de la perspective d’être livré au bistouri, pénètre dans le bloc opératoire cinq minutes plus tard avec le sourire. Durant les quelques minutes qu’il allait passer en compagnie du malade, tandis qu’il poussait le lit roulant dans les couloirs, il allait puiser dans son répertoire de plaisanteries, de propos de circonstance ou d’anecdotes, en fonction de l’âge de la personne, de son état, pour la distraire de ses préoccupations, et obtenir le sourire recherché. Personne ne lui demandait cela, cette tâche ne figurait pas dans sa fiche de poste, on ne le payait pas pour ça. Mais pour lui, c’était une dimension essentielle de son travail.
Deuxième constat : les personnes qui nous parlent de leur travail sont prises de façon considérable dans la relation aux autres. On ne fait jamais un travail seulement technique, seul dans son coin. Les autres sont là, sinon physiquement, du moins dans la tête. Je pense au texte d’un manageur qui travaille en open space, sous le regard de ses collègues et subordonnés, mais aussi avec les messages qui tombent, les réunions à assurer, à préparer puis à débrieffer, les relations à entretenir avec les prestataires, la hiérarchie, les clients. Et les journées passent à toute vitesse à se dépêtrer de tout cela. La relation aux autres est souvent stimulante, au meilleur de la coopération : ainsi pour l’équipe du canot de sauvetage en mer au cours d’une intervention périlleuse. Elle est parfois perturbante, quand le ton dérape. Elle est problématique lorsqu’on en est saturé, tout autant lorsqu’on en manque. Autre récit : celui d’une personne travaillant sur une aire de repos d’autoroute. Lui aussi voit passer énormément de monde, et son texte décrit les vagues successives de clients tout au fil de la journée. Mais la plupart ne le voient pas, ne le considèrent pas, parce qu’ils sont occupés à autre chose, parce qu’il est rendu anonyme par l’uniforme, invisible dans le décor standardisé, parce que, si on a affaire à lui, ce n’est que pour régler son sandwich ou son plein d’essence. Après avoir découvert ce récit, beaucoup de lecteurs nous affirment ne plus rentrer dans une aire de repos sans regarder et dire bonjour aux personnes qui sont là, qui travaillent à leur service…
Troisième idée : les travailleurs que nous rencontrons sont très soucieux du monde qui les environne. Ils ont bien conscience qu’au-delà de leur métier précis, au-delà de la préoccupation de gagner de quoi subvenir à leurs besoins, leur activité professionnelle leur fait porter une certaine responsabilité sociale. Une dame qui ne fait que cueillir des pommes dans les vergers toute la journée, des pommes et encore des pommes, dit son souci de la qualité des fruits, en les manipulant avec précaution d’une part, mais aussi en s’inquiétant de l’utilisation excessive de produits chimiques par le propriétaire. C’est une constante chez tous les travailleurs du monde agricole que nous rencontrons : ils ont conscience que leur travail est au service de l’alimentation de tous. Chacun se débrouille comme il peut de ces affaires de pesticides, d’engrais, de préservation des sols. Chacun a sa réponse propre, pense faire au mieux. Aucun n’est indifférent au fait qu’il s’agit au final, avec cette expression forte, de « nourrir le monde ».
À quoi bon dire le travail ?
Pour terminer, je voudrais dire quelques mots des finalités de notre démarche. Et ce, à partir de deux citations. L’une d’un sociologue français de l’après-guerre, Georges Friedmann : « L’homme est toujours plus grand que sa tâche. » On n’est jamais seulement infirmière, policier, secrétaire, mécanicien. On a besoin de se comporter comme un être humain à part entière, sans se laisser réduire à une fonction. Sur le plan politique, il nous semble aller de soi, en tout cas depuis qu’existe le suffrage universel, que n’importe quel citoyen est compétent pour déterminer les orientations politiques de la société dans laquelle il vit. Quelles que soient ses compétences, son niveau d’éducation, sa culture, son niveau d’information, son bulletin de vote vaut celui d’un autre. Dire le travail, c’est considérer que l’activité de chacun dépasse le seul accomplissement d’une tâche, contribue au fonctionnement du monde, et donc donne voix au chapitre pour décider de toutes les questions de la vie commune. Nous voulons contribuer à ce que cette conception de la citoyenneté franchisse les portes des institutions qui organisent le travail.
L’autre citation se trouve dans l’évangile de Matthieu : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je me permets une reformulation un peu plus laïque : l’être humain au travail ne cherche pas seulement des satisfactions matérielles ; il est toujours porté par autre chose, de l’ordre du symbolique. Pour le dire de façon dramatique : on ne se suicide pas au travail à cause d’une baisse de salaire ou d’une augmentation de son temps de travail. Des personnes en viennent à cette extrémité, comme le montre l’actualité, mais ce n’est jamais pour des questions matérielles. C’est souvent pour des mots, des paroles qui blessent, voire qui tuent lorsqu’elles portent sur la question essentielle de la reconnaissance de l’individu dans un collectif. L’activité de travail relie de façon très forte les sujets les uns aux autres et au monde, et c’est cela qui mérite d’être dit. En parlant de son travail, on parle de son humanité, de sa place dans le vivant, de ce qui nous transcende.
Patrice Bride, coopérative Dire Le Travail